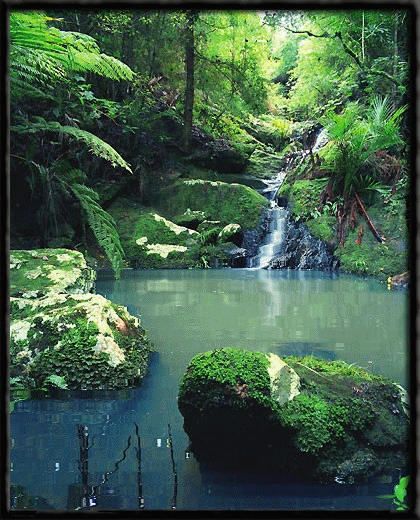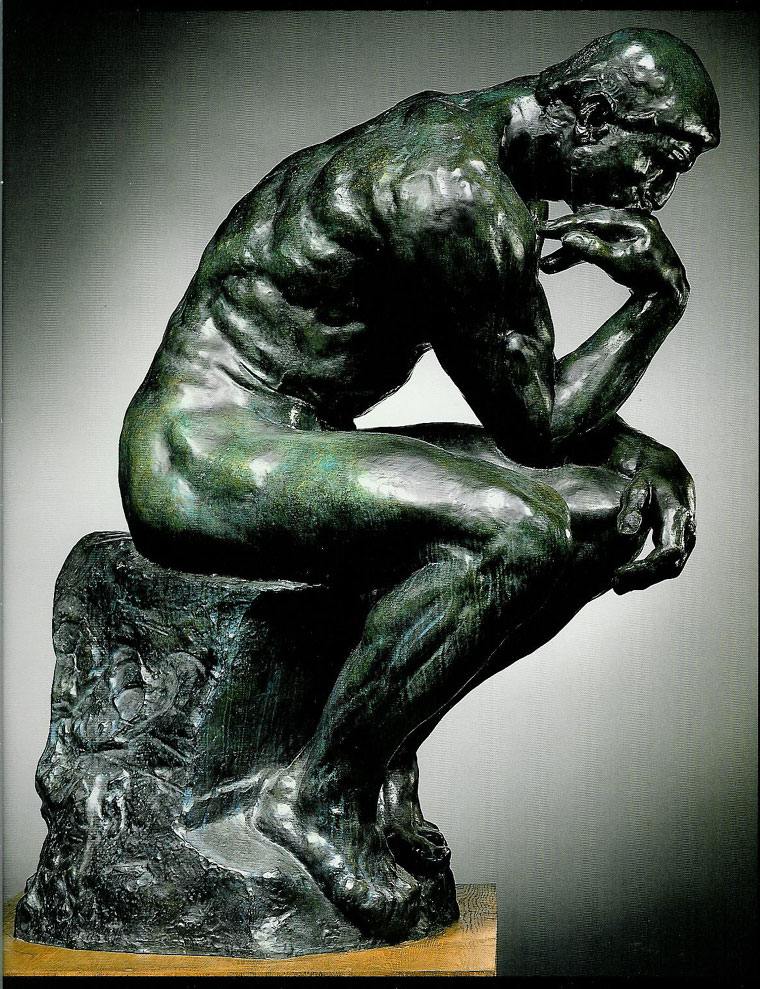LE TGOGO :Laïcité
La laïcité désigne le principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse. Elle désigne également le caractère des institutions, publiques ou privées, qui, selon ce principe, sont indépendantes du clergé et des Églises ; l'impartialité, ou la neutralité de l'État à l'égard des Églises et de toute confession religieuse1. neutralité vis-à-vis de toutes les religions
L'adjectif « laïque », dans son acception moderne, est dérivé du vocabulaire théologique : l'Église catholique distingue en effet parmi les chrétiens les laïcs, qui constituent la grande majorité des fidèles, et les clercs (évêques, prêtres, diacres), ministres ordonnés. Le mot "laïc" est toujours couramment utilisé dans l'Église, notamment par le concile Vatican II . Le néologisme « laïcité » est apparu au XIXe siècle. « Laïque » s'oppose donc d'abord à « clérical ». Par extension, il peut désigner tout individu qui n'est pas clerc ; il peut aussi désigner l'indépendance par rapport à toute autorité religieuse. Pour les républicains français de la troisième République, le cléricalisme renvoie, non à la religion, mais à la prétention des clercs à régir la vie publique d'un État au nom de Dieu ou de croyances religieuses. En proposant le concept de "laïcité", ces républicains, mettant en évidence que le clergé ne formait qu'une petite portion de chaque communauté de fidèles, ont fondé l'instauration progressive d'un rapport nouveau entre les laïcs, majoritaires dans ces assemblées, et les ministres des différents cultes.
![]()
Définition
Dans l'article « laïcité » de son Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire Ferdinand Buisson, un des inspirateurs des lois laïques de la troisième République, définit plus précisément la laïcité, terme alors nouveau (néologisme): il s'agit de la sécularisation des institutions politiques d'un État, à savoir que cet État ne s'adosse à aucune religion officielle, ni ne suppose quelque onction divine. Le principe de séparation des pouvoirs politique et administratif de l’État du pouvoir religieux en est une application. On ne doit donc pas confondre le caractère séculier d'une société (la population manifeste une certaine indifférence religieuse) avec la laïcité proprement dite (les institutions d'État ne sont soumises à aucune contrainte ni même ne relèvent d'aucune justification de nature religieuse, spirituelle ou théologique). Dans un État laïque, il ne saurait exister de religion civile, serait-elle négative (proposant comme chez Rousseau l'exclusion des croyances fanatiques, ou imposant l'athéisme comme dans les États communistes). Au sens contemporain, elle est le principe d'unité qui rassemble les hommes d'opinions, religions ou de convictions diverses en une même société politique, distincte par conséquent d'une communauté. Dans une perspective laïque, les croyances et convictions qui ont rapport à la religion (religions proprement dites, croyances sectaires, Déisme, Théisme, Athéisme, Agnosticisme, spiritualités personnelles) ne sont que des opinions privées, sans rapport direct avec la marche de l'État. C'est là considérer la politique comme une affaire humaine, seulement humaine. Réciproquement, la liberté de croyance et de pratique doit être entière; dans les limites de "l'ordre public", l'État s'interdit d'intervenir dans les affaires religieuses, et même de définir ce qui est religion et ce qui ne l'est pas (pas de religions officielles ni même reconnues selon l'article 2 de la loi de 1905).
Étymologie
![]()
Le mot « laïc », apparu au XIIIe siècle et d'usage rare jusqu'au XVIe siècle, est issu du latin laicus « commun, du peuple (laos) », terme ecclésiastique repris au grec d'église λα?κ?ς, laikos, « commun, du peuple (laos) », par opposition à κληρικ?ς, klerikos (clerc), désignant les institutions proprement religieuses. Le terme laicus est utilisé dans le vocabulaire des églises chrétiennes dès l'Antiquité tardive pour désigner toute personne de la communauté qui n’est ni clerc, ni religieux; c'est-à-dire profane en matière de théologie. Cependant, elle appartient bien à l'Église, dans le sens qu'elle en suit le culte (l'incroyance étant alors inconcevable à l'époque); et peut même y exercer des fonctions importantes. L'abstrait désignant cette position a donné en français le terme « laïcat ». Au Moyen Âge, le mot « laïc » distingue l'homme commun, qui doit être enseigné, de l'individu instruit consacré par son état religieux.
Le concept de laïcité, en tant que séparation du pouvoir ecclésiastique et du pouvoir séculier, est ancien, mais ne s'exprime pas d'emblée dans le champ lexical du laïcat. Au Ve siècle, le pape Gélase Ier conçoit le premier dans une lettre à l'empereur Anastase, la distinction entre le pouvoir temporel (potestas) et de l’autorité spirituelle (auctoritas). Cette lettre, préfigurant la doctrine médiévale des deux glaives, devient à fin du XIe siècle l’un des textes clefs invoqués pour soutenir la supériorité de l’autorité pontificale sur la potestas impériale. Mais l'usage qui en est fait alors, dans l'optique de la séparation du regnum et du sacerdotium, provient de l’importance excessive accordée à ce qui est en fait une citation altérée de la lettre de Gélase, qui mentionnait « deux augustes impératrices gouvernant le monde ». La distinction entre potestas et auctoritas tente d'établir une hiérarchie : le pouvoir politique serait moralement soumis à l'autorité. Cette dichotomie entraîne des réactions qui se traduisent notamment par la lutte du sacerdoce et de l'Empire ou par les mouvements hérétiques des XIVe et XVe siècle qui contestent au clergé cette mainmise spirituelle.
Les racines de la notion de laïcité
Le concept de laïcité trouve ses racines dans les écrits des philosophes grecs et romains, tels que Marc-Aurèle[réf. nécessaire] et Épicure11 , ceux des penseurs des Lumières comme Locke, Bayle, Diderot, Voltaire, les pères fondateurs des États-Unis tels James Madison, Thomas Jefferson, et Thomas Paine, en France à travers les lois de Jules Ferry, ainsi que dans les écrits de libres penseurs modernes, agnostiques et athées, tels que Bertrand Russell, Robert Ingersoll, Albert Einstein, et Sam Harris.
La notion moderne de laïcité, qui n'est plus hiérarchique, apparaît quand la théorie politique puis l'État deviennent capables d'une pensée autonome sur la question religieuse. Dans un premier temps, les philosophes des Lumières, comme Voltaire, se sont mis à parler de prêtres ou de missionnaires laïques pour désigner la vocation morale hors du clergé et des doctrines religieuses[réf. nécessaire]. Les termes « laïcité », « laïciser », « laïcisation », ne sont attestés qu'à partir de la chute du Second Empire, en 1870 : le terme « laïcité » est contemporain de la Commune de Paris qui vote en 1871 un décret de séparation de l'Église et de l'État. Ils sont liés, sous la Troisième République, à la mise en place progressive d'un enseignement non religieux mais institué par l'État. Le substantif « la laïque », sans autre précision, désignait familièrement l'école républicaine. La laïcité sécularise alors la puissance publique et renvoie l'activité religieuse à la sphère privée.
Est désormais laïque (au sens de Laos « la population indivise ») « ce qui concerne tout le peuple, indépendamment des diverses croyances ou convictions qui le divisent ». Cette définition contemporaine se rapproche de celle qu'avait retenue Ferdinand Buisson dans son Nouveau dictionnaire de pédagogie (1911) :
« Les laïques, c'est le peuple, c'est la masse non mise à part, c'est tout le monde, les clercs exceptés, et l'esprit laïque, c'est l'ensemble des aspirations du peuple, du laos, c'est l'esprit démocratique et populaire. »
Selon Henri Pena-Ruiz, dans la cité grecque (et dans la cité latine préchrétienne postérieurement) la religion organise le lien social. Puis, la cité se faisant intégrante, des croyances multiples cohabitèrent. Chaque citoyen a ses dieux personnels, dans une cité qui a les siens propres (les dieux poliades) et dont la vocation est de préserver le salut commun. Progressivement, le conformisme religieux laisse la place à des lois communes, afin de favoriser la coexistence de tous. La religion de la cité aura alors une fonction civique dépourvue de dogmatisme théologique ; on admettra progressivement que la conscience reste maîtresse d’elle-même. Le droit romain développera cette distinction entre lois communes et pouvoir religieux en distinguant la res publica (la « chose publique ») de la chose privée. Ainsi sont réunies les composantes de la laïcité contemporaine : le respect de la conscience individuelle, la recherche de l’intérêt général, la primauté de la loi sur les dogmes.
La laïcité contemporaine:
Principe d'unité
Aujourd'hui, une organisation commune fondée sur la laïcité permet de prendre en compte la diversité des hommes et la nécessité de les unir pour assurer leur coexistence.
« Elle le fait en conjuguant la liberté de conscience, qui permet aux options spirituelles de s'affirmer sans s'imposer, l'égalité de droits de tous les hommes sans distinction d'option spirituelle, et la définition d'une loi commune à tous visant le seul intérêt général, universellement partageable. »
Jean Baubérot emploie une formule semblable en définissant la laïcité contemporaine sous trois aspects : l’État est sécularisé, la liberté de croyance et de culte est garantie, et les croyances sont égales entre elles. Il remarque cependant que chacun insiste davantage sur l'un ou sur l'autre de ces trois aspects: le laïciste sur la sécularisation, le croyant, sur la liberté de conscience, et enfin celui qui adhère à des croyances minoritaires sur l'égalité entre toutes les croyances. (référence : Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, Le Seuil, 2004.)
Différentes conceptions de la laïcité
La conception française
Principe
En France, le concept de laïcité est avant tout une histoire conflictuelle opposant tout au long du XIXe siècle deux visions de la France. Les catholiques,qui avaient joué un rôle décisif dans la Révolution de 1789 avec le ralliement du clergé au Tiers-État, sont durablement traumatisés par la persécution qui les frappe sous le régime totalitaire de la Terreur. La majorité d'entre eux soutient le camp conservateur au XIXe siècle, contre une partie de la société civile plus progressiste et acquise aux idées des Lumières. La conception française de la laïcité est, dans son principe, la plus radicale des conceptions de la laïcité (comparativement), quoiqu’elle ne soit pas totale. La justification de ce principe est que, pour que l’État respecte toutes les croyances de manière égale, il ne devrait en reconnaître aucune. Selon ce principe, la croyance religieuse relève de la sphère privée. De ce fait, l’État n’intervient pas dans la religion du citoyen, pas plus que la religion n’intervient dans le fonctionnement de l’État. L'organisation collective des cultes doit se faire dans le cadre associatif. La laïcité à la française pose comme fondement la neutralité religieuse de l’État. L’État n’intervient pas dans le fonctionnement de la religion, sauf si la religion est persécutée (article 1 de la loi du 9 décembre 1905 : "l’État garantit l’exercice des cultes.").
Ce principe a été énoncé essentiellement en deux temps :
- d’une part, sous la Révolution française, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (qui fait cependant référence à un Être Suprême, voire supra) et qui est reprise par le préambule de la Constitution de 1958, dont l’article Ier rappelle que : La France est une République laïque ;
- et d’autre part, par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, qui introduit les principes de non-ingérence et de séparation avec les institutions religieuses ; les institutions religieuses ne peuvent avoir d’influence sur l’État et l’État ne peut avoir d’influence sur les Églises ou leurs croyants sauf en tant que citoyen : la séparation est donc réciproque.
La conception française de laïcité, dans son principe la plus radicale, a été extrêmement marquée dans son application pratique par le fait qu'elle a été élaborée dans un esprit antireligieux par certains protagonistes, comme le socialiste Viviani, qui considéraient la Séparation comme un combat anticlérical, consistant non pas à séparer le pouvoir politique du fait religieux en tant que tel, mais à réduire l’influence de l’Église Catholique et des militants politiques chrétiens. D'autres, tel Aristide Briand, avaient une vision moins sectaire et considéraient la laïcité comme la nécessaire neutralité de l’État par rapport au fait religieux.
Les dispositions de la loi, dont il est question ici, n'ont pas fait l’objet d’une négociation entre l’Église Catholique et le législateur. C'est seulement au sein du Parlement qu'eut lieu le débat, sous la direction assez modérée d'Aristide Briand, rapporteur du projet de loi. Ce n'est qu'en 1923 qu'un compromis sera négocié entre l'État et l’Église Catholique, avec notamment la création des associations diocésaines. Les autres cultes (protestant et juif) ont accepté de se constituer en associations cultuelles suivant les modalités de la loi de 1905.
Le principe de laïcité ne s’est appliqué qu’aux citoyens et en France métropolitaine. Dans les colonies et même en Algérie (départementalisée), la population d'origine indigène n'avait pas la pleine citoyenneté et le droit qui s'appliquait faisait une large place aux coutumes locales, y compris en matière de place des cultes, des structures religieuses et de leurs ministres. De cette situation proviennent, d’ailleurs, les problèmes d’intégration en France à partir des années 1960, lorsque les immigrés de ces colonies, qui pouvaient jusqu’alors publiquement exercer leur religion, sont arrivés en France où il était d’usage tacite de se confondre dans la population.
Énoncé en 1905, le principe de laïcité ne s'applique pas non plus en Alsace-Moselle, (qui ne fut réintégrée à la France qu'en 1918 et imposa cette condition à sa réintégration) pour ce qui concerne l'éducation - et où le régime du concordat prévaut -, ni à Mayotte pour les principes du droit (où la loi islamique, la charia, s’applique selon le recueil de jurisprudence, le minhadj, même si l'on observe que le droit coutumier local opère un glissement vers le droit commun) ou à Wallis-et-Futuna pour le système éducatif en primaire (où l'enseignement est concédé par l'État au diocèse catholique).
Aujourd’hui, des propositions d’inclusion de la notion de valeurs, ou de racines, chrétiennes ou même simplement "religieuses" dans la Constitution européenne suscitent une vigilance accrue de milieux attachés à la laïcité: le mot "racines" n'étant pas suivi de l'adjectif "historiques" pourrait en effet être interprété par la suite comme "fondatrices".
Applications concrètes du principe
La première et plus importante traduction concrète de ce principe en France concerne l’état civil, auparavant tenu par le curé de la paroisse qui enregistrait la naissance, le baptême, le mariage et la sépulture des personnes. Depuis 1792, il est tenu par l’officier d’état civil dans la commune (le maire) et tous les actes doivent être enregistrés devant lui.
Les sacrements religieux (mariage et baptême notamment) n’ont plus de valeur légale et n’ont qu’un caractère optionnel.
Le mariage religieux ne pourra être effectué que postérieurement à un mariage civil. Le ministre du culte qui ne respecte pas cette règle est répréhensible pénalement (art 433-21 du Code pénal). Cette règle pratique constitue une exception au principe de neutralité par rapport aux sacrements puisqu'elle soumet le droit au mariage religieux à l'accomplissement préalable d'un acte d'état civil. Elle s'explique en France par une raison historique : à l'époque de l'instauration du mariage civil, le législateur craignait qu'une grande partie des couples contractent des mariages uniquement religieux et se retrouvent, sur le plan civil, en situation de concubinage, ce qui était considéré comme immoral. Bien qu'obsolète de nos jours (et parfois même dénoncée comme une atteinte inutile à la liberté religieuse), cette règle est restée en vigueur.
Bien qu'il existe un baptême civil, celui-ci n'ayant pas de valeur légale il ne s'impose pas avant le baptême religieux.
Par principe, la laïcité est un concept étroitement lié à celui de la liberté d’expression et d’opinion. Il est permis à chacun de pratiquer la religion de son choix, tant que cette pratique ne va pas à l’encontre des droits d’autrui. Les démonstrations d'appartenance à une religion peuvent cependant être restreintes. C’est le cas notamment des fonctionnaires, qui durant leur service n’ont pas le droit de porter de signes religieux. De même, il est interdit d'afficher des signes ostentatoires religieux dans les écoles de la République. Là encore, il ne s'agit pas spécifiquement d'une application du principe de laïcité, le même interdit existant pour d'autres convictions (politiques par exemple).
L’État ne doit ni poser des questions (dans le cadre d'un recensement), ni distinguer entre les personnes sur la base de critères religieux. Ce n'est toutefois pas une application du principe de laïcité, le même interdit existe pour d'autres catégorisations sensibles (origine ethnique, couleur de peau, appartenance politique ou syndicale, etc.). Au niveau collectif, le fait qu'une organisation soit ou non affiliée à une religion ne peut pas non plus entrer en considération : seules les activités cultuelles sont exclues, mais un club sportif dépendant d'une église peut obtenir des subventions aussi bien qu'un club laïc, dans la mesure où il est aussi ouvert aux laïcs. De même, les écoles confessionnelles peuvent participer au service public de l'éducation (l'État en paye alors les professeurs et les collectivités territoriales peuvent contribuer à leur bonne marche), ce qui implique notamment qu'elles respectent les programmes officiels, et qu'elles doivent accueillir tous les élèves qui le souhaitent, indépendamment de leur religion et sans prosélytisme dans le cadre des cours. 90 % des écoles privées en France sont catholiques.
Dans le système éducatif françaiset dans les pays Francophones d'Afrique et la formation religieuse (dans le sens « enseignement de la foi ») ne fait pas partie du cursus des élèves (cas du TOGO ); néanmoins, une demi-journée par semaine est libre justement pour que cet enseignement puisse être assuré (le mercredi), et d'autre part les établissements peuvent disposer d'aumôneries et de groupes de pratiquants actifs, même dans le cadre d'un établissement public, et a fortiori dans les établissements privés : l'exercice du culte est libre même à l'intérieur des établissements publics, à condition de ne pas perturber le fonctionnement ni de se transformer en prosélytisme (impossible d'interrompre la classe pour une prière, d'exiger un menu spécifique à la cantine, ou de squatter la cour de récréation pour une messe, par contre on peut disposer d'une salle libre par ailleurs pour cela). De même, les signes religieux "ostentatoires" sont interdits dans les écoles publiques.
Il existe en outre des propositions pour que le fait religieux, un enseignement descriptif des caractéristiques des religions (dogmes, structures, histoire, etc.) soit inscrit aux programmes. Les rapports Debray (2002) et Stasi (2003) conseillent d'aborder les faits religieux comme des faits sociologiques.
La laïcité a également été invoquée au début du XXe siècle pour justifier les brimades faites aux langues régionales. La langue de la république étant le français, aucune autre langue n'était tolérée dans ses écoles, et les contrevenants étaient punis, parfois de façon corporelle, et humiliés, par l'utilisation du symbole notamment.
Exceptions
![]()
![]()
Pour des raisons historiques, il existe certaines exceptions locales : l'acte de naissance pratique du principe de laïcité est la loi de 1905 qui ne s’appliquait alors pas outre-mer, ni en Alsace-Moselle, alors annexée par l'Empire allemand suite à la défaite française de la Guerre franco-prussienne de 1870.
Après la victoire de la Triple-Entente à l'issue de la Première Guerre mondiale, lors du rattachement de l'Alsace-Moselle au territoire national français, s'est posé la question de l'extension du corpus juridique français à ces régions, qui en avaient été séparé pendant plus de 40 ans. Suite à la demande unanime des députés locaux , subsistent diverses dispositions relevant du droit local : un statut scolaire particulier où l’enseignement religieux est obligatoire, un statut différent pour les associations et le maintien du Concordat. Dans ces régions improprement appelées concordataires (le Concordat ne s’applique en principe qu’aux citoyens de confession catholique, les articles organiques régissant les autres cultes), les ministres des cultes sont rémunérés par l’État et réputés personnels de la fonction publique et l’école publique dispense des cours d’instruction religieuse (catholique, luthérienne, réformée ou israélite). Les cultes reconnus sont très encadrés (nomination des évêques par le ministre de l’Intérieur...) ; les actes d’état civil continuent d’être du domaine de l’État. L’Islam n’y est pas un culte reconnu (il n’y avait pas de musulmans en France en 1801), mais certaines règles lui sont appliquées (construction de la mosquée de Strasbourg...).
La conception des USA
![]()
Les États-Unis apparaissent de nos jours comme une république fortement imprégnée par les valeurs chrétiennes (tradition puritaine pour la Nouvelle-Angleterre, mais aussi baptiste, méthodiste, et catholique). Pourtant, dès l’époque de la Révolution américaine, l’idée de laïcité est un concept incontournable en Amérique, hérité des Lumières, et plus spécifiquement du philosophe anglais John Locke. Ainsi, la Déclaration d'indépendance américaine fut rédigée par des déistes, les Pères fondateurs étaient également dans leur majorité des laïcs attachés à la séparation de l'Église et de l'État. Ainsi, Thomas Jefferson, en 1776, s'il fait référence à un Dieu créateur qui légitime les droits de l’Homme, était également farouchement attaché à cette idée, comme en témoignent ses écrits :
« J’ai toujours considéré qu’il s’agissait d’une affaire entre l’homme et son créateur, dans laquelle personne d’autre, et surtout pas le public, n’avait le droit d’intervenir. »
Dans l’une de ses lettres, Jefferson évoque l’impérieuse nécessité d’un « mur de séparation » entre l’État et les Églises. D’autres pères fondateurs des États-Unis se sont prononcés en faveur de la séparation des Églises et de l’État :
« Tous possèdent également la liberté de conscience et les protections de la citoyenneté. Le gouvernement des États-Unis n’apporte aucun soutien au sectarisme, ni aucune assistance à la persécution, et requiert seulement que tous ceux vivant sous sa protection se conduisent en bons citoyens [...] Les croyances religieuses d’un homme ne le priveront pas de la protection des lois, ni du droit d’obtenir et d’exercer les plus hautes fonctions publiques existantes aux États-Unis. »
« Le gouvernement n’a pas l’ombre d’un droit de se mêler de religion. Sa plus petite interférence serait une usurpation flagrante. »
« Le gouvernement des États-Unis n’est en aucune manière fondé sur la religion chrétienne ; il n’a aucune inimitié envers la loi, la religion ou la tranquillité des musulmans. »
« De toutes les tyrannies qui frappent l’humanité, la pire est la tyrannie en matière de religion. »
Les pères fondateurs américains en faveur de la laïcité
George Washington1732/1739 Officiellement, la religion est séparée de l’État par le premier amendement du 12 décembre 1791 de la constitution de 1787. Fait notable pour l’époque, ni la constitution ni la Déclaration des Droits (les dix premiers amendements), les deux textes fondateurs de la République américaine, ne font référence à Dieu ou à la Providence. Ainsi, depuis la fin du XVIIIe siècle , il n’y a pas de religion officielle dans ce pays. Pourtant, les références à Dieu sont omniprésentes dans la pratique politique : George Washington, fut le premier président à introduire le serment sur la Bible, alors que la constitution ne prévoyait qu’un simple serment. On note également le In God we trust sur les pièces et billets (En Dieu, nous avons confiance) qui est devenu une devise officielle des États-Unis le 30 juillet 1956, sur l’initiative d’un député de Floride (Charles E. Bennett). Dans les États où, à l'occasion d'un procès (ou de la prise de fonction d'un gouverneur ou d'un shérif, par exemple), les témoins doivent jurer de dire la vérité sur un « document sacré », le choix est possible entre tous les « documents » disponibles : Bible chrétienne sans apocryphes, Bible chrétienne avec écrits intertestamentaires, Torah, Coran, Avesta, etc. Contrairement par exemple à la France, cependant, dans le système éducatif américain, l’État fédéral ne subventionne aucune école religieuse[réf. nécessaire]. Enfin, il ne faut pas oublier que le premier amendement fait partie de la première constitution à garantir la non-ingérence de l’État dans les religions et la liberté de culte. En 1875, James Blaine, président de la Chambre des représentants, proposa un amendement constitutionnel interdisant les subventions publiques pour tout projet à vocation religieuse. Cet amendement Blaine, bien que rejeté par le Sénat, fut adopté par 37 états américains, qui donc ne subventionnent aucune école privée. L'arrivée du chèque éducation a remis en cause cette décision. La définition du Dieu auquel se réfère l’État américain est pensée et vécue comme le point commun à toutes les religions ; il ne s’agit donc pas d’un Dieu précis, attaché à un culte défini. D’une manière différente de la France, où l’État rassemble par son indifférence aux cultes, l’État américain rassemble en créant un point commun qui est le fait de croire. C’est la conséquence étonnante d’une telle laïcité : en se refusant toute ingérence étatique dans la vie religieuse des citoyens, les fondateurs des États-Unis ont attiré dans leur pays de nombreux immigrants très religieux, parfois brimés dans leurs pays d’origine : mennonites, baptistes, anabaptistes, amishs, quakers, juifs, etc. La forte religiosité américaine, qui connaît son pic pendant la guerre froide, n’est donc pas le vœu des fondateurs du pays mais la conséquence des conditions dans lesquelles le pays s’est construit.
La religion est considérée aux États-Unis dans un sens proche de l’étymologie (religio : créer un lien social). Dans ce cadre, agnostiques et athées sont mal conceptualisés dans le système, car toute personne se rattache par principe à une religion. Une étude de l’université du Minnesota publiée en 2006 montre d’ailleurs que la « communauté » qui inspire la méfiance la plus grande aux États-Unis est non pas celle des immigrants récents, celle des homosexuels ou celle des musulmans, mais bien celle des athées. Néanmoins, la méfiance qu’inspirent les athées aux États-Unis dépend énormément du lieu de résidence des populations étudiées : les habitants de la côte ouest autant que ceux de la côte est, c’est-à-dire une majorité d’Américains, acceptent bien mieux l’athéisme que ne le font ceux qui habitent au centre du pays.
La conception turque
La Turquie est actuellement un État laïque de par sa constitution, et ce depuis le 10 novembre 1937. La Constitution du 20 janvier 1921, ne mentionne ni une religion ni la laïcité ; la loi constitutionnelle du 29 octobre 1923 en modifie l’article 2 en indiquant que « la religion de l’État turc est l’islam » (Türkiye Devletinin dini, Dîn-i ?slâmd?r). Cette mention est conservée dans la constitution du 20 avril 1924 (dont l’article 75 proclame pourtant la liberté de conscience et de culte - à condition qu’elles ne s’opposent pas aux lois), supprimée le 11 avril 1928 et remplacée le 10 décembre 1937 par « l’État turc est républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïque et réformateur » (Türkiye Devleti, Cumhûriyetçi, Milliyetçi, Hâlkç?, Devletçi, Laik ve ?nk?lâpç?’d?r), les « six principes d’Atatürk ».
Les imams turcs sont des fonctionnaires payés par l'État et dépendant du Ministère des affaires religieuses qui entretient aussi des missions à l'étranger. La religion figure sur la carte d'identité. L'islam est enseigné dans les écoles (http://www.flw.ugent.be/cie/aydin_manco1.htm) La Turquie est un des quelques pays majoritairement musulmans, comme certains États africains ou de l'ex-URSS, à être laïque. Cependant, la séparation entre les Églises et l’État n’est pas réciproque comme en France : la laïcité s'accommode d'une mise sous tutelle de la religion par l'État, qui finance et forme des prêtres et des écoles religieuses. Par ailleurs, elle est juridiquement considérée comme étant liée à l'ordre public, ce qui a été réaffirmé par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire Leyla Sahin contre Turquie (en) (2004-2005) , dans laquelle la CEDH a soutenu l'interdiction du voile dans certains cas.
La conception indienne
En 1947, l'Empire britannique des Indes est divisé en deux pays: le Dominion du Pakistan à majorité musulmane et l'Union indienne à majorité hindoue. Cette partition fait suite aux tensions entre les deux communautés et à la "théorie des deux nations", prônée notamment par la Jinnah et la Ligue musulmane selon laquelle l'Inde serait composée de deux nations fondées sur leurs religions. Cette théorie n'était pas partagée par le Congrès national indien et Nehru: alors que le Pakistan devenait un pays officiellement islamique, l'Inde, qui continuait d'abriter un tiers des musulmans de l'ancien Empire des Indes, optait pour la laïcité et refusait de se définir comme uniquement hindoue.
En 1950, la laïcité en est inscrite dans plusieurs articles de la Constitution du pays: l'article 15 interdit les discriminations sur la base de la religion, la race, la caste, le sexe ou le lieu de naissance, l'article 25 consacre la liberté de conscience et la pratique et propagation libre de la religion, l'article 26 protège la liberté des religions de régler leurs propres affaires. En 1976, ces dispositions ont été complétées par l'introduction du mot SECULAR devant DEMOCRATIC REPUBLIC dans le préambule de la Constitution.
Cependant, même si l'Inde est officiellement laïque ("secular"), elle reconnait le droit basé sur la religion. Ainsi, les hindous, les musulmans et les chrétiens sont sujets chacun à leur propre droit civil. Par ailleurs, une partie importante de la classe politique, notamment le Bharatiya Janata Party, adhère au concept d'hindutva qui considère l'Inde comme la patrie des hindous, en opposition aux influences "extérieures" - notamment l'islam et le christianisme - et prône un État hindou. Ce courant, classé à droite, s'oppose au Congrès, partisan de la laïcité.
La conception indienne de la laïcité est donc relativement différente de la conception française, d'autant plus que les Indiens affichent volontiers leurs croyances religieuses dans l'espace public. Ainsi, la loi française sur les signes religieux dans les écoles publiques a fait l'objet de contestations de la part de sikhs, tant en Inde qu'en France.
Aujourd’hui
Le principe de laïcité donne lieu à des débats, car il doit pouvoir se concilier avec l’exercice du culte, c'est-à-dire éviter les ingérences tout en garantissant la liberté de conscience. Par ailleurs il est incompatible avec certaines croyances religieuses selon lesquelles, justement, la religion doit déterminer les affaires publiques et ne peut pas être une affaire privée.
Au niveau législatif
La loi ne tire pas sa légitimité formelle d’une conformité à des préceptes religieux. Pour autant, compte tenu du rôle historique des religions, la loi peut contenir des articles qui peuvent être mis en correspondance avec des préceptes moraux ayant une origine religieuse.
Les États laïques sont plus ou moins éloignés des prescriptions religieuses selon la conception qu’ils ont de cette laïcité. Ils défendent les droits de chaque citoyen contre d’éventuelles règles religieuses qui seraient en contradiction avec l’ordre public, particulièrement avec les droits et les libertés de chacun.
Au niveau judiciaire
![]()
Le citoyen est jugé indépendamment de ses convictions religieuses.
Au niveau exécutif
![]()
L’exercice du pouvoir politique n’est conditionné ni par le respect de prescriptions religieuses ni par l’appartenance à un groupe religieux.
Laïcité par pays
À partir du moment où la liberté de culte est assurée, on s’aperçoit que l’influence des Églises n’est pas directement corrélée à leur statut juridique. Par exemple la Suède, pays reconnaissant l’Église évangélique luthérienne comme religion d’État jusqu’au 1er janvier 2000, est certainement l’un des pays les moins religieux d’Europe, car en un siècle l’Église de Suède est devenue, comme la monarchie, un simple folklore pour la plupart des habitants. Au contraire, des pays de constitution laïque comme le Portugal ont une tradition catholique toujours vivace. Le classement suivant repose donc uniquement sur le statut juridique des Églises, sans présumer de leur poids politique effectif.
LE TOTALITARISME:
LA DICTATURE POLITIQUE
CONCEPT ALLEMAND
Benito Mussolini et Adolf Hitler, 1937.
Le totalitarisme est le système politique des régimes à parti unique, n'admettant aucune opposition organisée, dans lequel l'État tend à confisquer la totalité des activités de la société. Concept forgé au XXe siècle, durant l'entre-deux-guerres, le totalitarisme signifie étymologiquement « système tendant à la totalité, à l'unité ».
L'expression totalitaire vient du fait qu'il ne s'agit pas seulement de contrôler l'activité des hommes, comme le ferait une dictature classique : un régime totalitaire tente de s'immiscer jusque dans la sphère intime de la pensée, en imposant à tous les citoyens l'adhésion à une idéologie obligatoire, hors de laquelle ils sont considérés comme ennemis de la communauté.
Les caractéristiques habituellement retenues pour définir le totalitarisme sont : une idéologie imposée à tous, un parti unique contrôlant l'appareil d'État, dirigé idéalement par un chef charismatique, un appareil policier recourant à la terreur, une direction centrale de l'économie, un monopole des moyens de communication de masse et un monopole de la force armée.
Les origines du concept
Bien souvent, la genèse du concept de totalitarisme est attribuée à la philosophe Hannah Arendt, alors qu'elle a lieu bien avant, dans l'entre-deux-guerres. L'adjectif « totalitaire » (« totalitario ») apparut en Italie dès le mois de mai 1923 (on prête parfois son invention à Giovanni Amendola, opposant et victime du fascisme). Ce concept fut d'emblée un instrument de lutte politique. Son emploi se répandit de manière péjorative dans les milieux antifascistes italiens. En 1925, les théoriciens du fascisme reprirent de manière opportuniste le terme à leur compte, en lui attribuant une connotation positive, celle d'unité du peuple italien. Benito Mussolini exaltait sa « farouche volonté totalitaire », appelée à délivrer la société des oppositions et des conflits d'intérêts. Giovanni Gentile, théoricien du fascisme, mentionna le totalitarisme dans l'article « doctrine du fascisme » qu'il écrivit pour Enciclopedia Italiana et dans lequel il affirma que « ... pour le fasciste tout est dans l'État et rien d'humain et de spirituel n'existe et il a encore moins de valeur hors de l'État. En ce sens le fascisme est totalitaire.. ». Dans la seconde moitié des années 1920, l'ancien président du Conseil des ministres italien Francesco Saverio Nitti « aurait le premier établi des rapprochements entre la structure du fascisme italien et le bolchevisme ».
L'écrivain allemand Ernst Jünger, par son exaltation de la « mobilisation totale », décrit les contours du totalitarisme. Il célèbre la guerre et la technique moderne comme annonciatrices d'un nouvel ordre, incarné par la figure de l'ouvrier-soldat, œuvrant au sein d'une société encadrée et disciplinée comme une armée. Selon lui, la Première Guerre mondiale avait marqué un tournant historique vers cette forme nouvelle de civilisation : pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, les forces humaines et matérielles du monde industriel moderne avaient été mobilisées dans leur « totalité » pour accomplir l'effort de guerre.
La première utilisation du terme de totalitarisme pour désigner dans le même temps les États fasciste et communiste semble avoir été faite en Grande-Bretagne en 1929. Dans les années 1930, le concept fut utilisé sous la plume d'écrivains pro-nazis. Carl Schmitt employait ce terme pour mettre en lumière la crise du libéralisme et du parlementarisme et exprimer la nécessité d'une politique plus autoritaire. Simone Weil écrivait en 1934 : « il apparaît assez clairement que l'humanité contemporaine tend un peu partout à une forme totalitaire d'organisation sociale, pour employer le terme que les nationaux-socialistes ont mis à la mode, c'est-à-dire à un régime où le pouvoir d'État déciderait souverainement dans tous les domaines, même et surtout dans le domaine de la pensée. »
Le régime autoritaire franquiste issu de la guerre civile espagnole s’est défini comme totalitaire dans ses premières années, affirmant ainsi sa parenté avec le fascisme, avant d'effacer ce terme de la constitution. Il en est de même du régime impérial japonais lors de la première partie de l'ère Sh?wa, à compter de la constitution de l'Association de Soutien à l'Autorité Impériale. En 1940, dans une entrevue accordée au New York Herald, le ministre des Affaires étrangères du cabinet de Fumimaro Konoe, Y?suke Matsuoka, n'hésitait pas à faire l'apologie du totalitarisme, prédisant sa « victoire sans équivoque dans le monde » et « la banque eroute du système démocratique ».
Emblème de l'Association de Soutien à l'Autorité Impériale (Taisei Yokusankai), le parti fondé le 12 octobre 1940 par Fumimaro Konoe, qui visait à implanter au sein de l'empire du Japon une structure totalitaire destinée à promouvoir la guerre totale.
Dans le monde anglo-saxon, William Henry Chamberlin et Michael Florinsky ont été parmi les premiers à faire usage du concept de totalitarisme. Divers théoriciens de gauche, comme Franz Borkenau ou Richard Löwenthal, ont employé le concept « pour caractériser tout ce qui leur paraît nouveau et spécifique dans le fascisme (ou le nazisme), en dehors de toute comparaison avec le communisme soviétique». Le concept de totalitarisme cristallisait également la réflexion sur les formes modernes de tyrannie et, plus particulièrement, sur la violence exercée sur autrui, qui semblait inséparable du fonctionnement des régimes nazi et communiste. Finalement, les traits fondamentaux qui ont dominé la discussion de l'après-guerre sur le totalitarisme étaient déjà présents dans les années 1930. Pierre Hassner affirme : « On peut dire qu'en un sens Hannah Arendt n'a fait que nouer en une synthèse géniale [...] les différents éléments en dégageant la logique qui les sous-tendait. »
Le pacte germano-soviétique, signé en 1939 entre l'Allemagne nazie et l'URSS, fut présenté par certains comme une illustration de l'apparition d'un nouveau type de régime (l'antithèse du libéralisme) qui ferait le lien entre les idéologies fasciste et soviétique. Par exemple, dans The Totalitarian Enemy, paru à Londres en 1940, l'ancien communiste autrichien Franz Borkenau voulait éclairer l'opinion publique sur les vrais enjeux de la guerre : il s'agissait de détruire le totalitarisme incarné dans le nazisme et le bolchevisme. Les différences entre ces deux courants étaient minimes pour l'auteur : le bolchevisme se limitait à un « fascisme rouge » et le nazisme à un « bolchevisme brun ». D'après Borkenau, la dynamique inhérente au marché capitaliste conduisait inévitablement à une centralisation et une planification de l'économie : la révolution totalitaire n'était rien d'autre que la révolution socialiste prophétisée par Karl Marx. Mais cette sous-estimation des différences entre le bolchevisme et le nazisme « ne diminue pas, selon Krzysztof Pomian, l'importance historique de Totalitarian Enemy. Y sont évoqués, en effet, presque tous les thèmes repris plus tard par l'abondante littérature consacrée au totalitarisme. »
Des définitions diverses
Définition selon Hannah Arendt
CONCEPT RUSSE
Parade en l'honneur de Staline, Dresde, Allemagne de l'Est, 1953.
La philosophe Hannah Arendt a apporté une définition du concept de totalitarisme dans son livre Les Origines du totalitarisme (1951). Selon elle, deux pays seulement avaient alors connu un véritable totalitarisme : l'Allemagne sous le nazisme et l'URSS sous Staline. Elle distingue toutefois des tendances ou des épisodes totalitaires en dehors de ces deux cas. Elle cite notamment le maccarthisme au début des années 1950 aux États-Unis ou encore les camps de concentration français où furent enfermés les réfugiés de la guerre d'Espagne.
Ces régimes n'admettent qu'un parti unique qui contrôle l'État, qui lui-même s'efforce de contrôler la société et plus généralement tous les individus dans tous les aspects de leur vie (domination totale). D'un point de vue totalitaire, cette vision est erronée : il n'y a qu'un parti parce qu'il n'y a qu'un tout, qu'un seul pays, vouloir un autre parti c'est déjà de la trahison ou de la maladie mentale (schizophrénie : se croire plusieurs alors qu'on est un).
Le totalitarisme tel qu'il est ainsi décrit par Hannah Arendt n'est pas tant un « régime » politique qu'une « dynamique » autodestructive reposant sur une dissolution des structures sociales.
Dans cette optique, les fondements des structures sociales ont été volontairement sabotés ou détruits : les camps pour la jeunesse ont par exemple contribué à saboter l'institution familiale en instillant la peur de la délation à l'intérieur même des foyers, la religion est interdite et remplacée par de nouveaux mythes inventés de toute pièce ou recomposés à partir de mythes plus anciens, la culture est également une cible privilégiée. Hanns Johst avait ainsi écrit dans une pièce de théâtre : « Quand j'entends le mot culture, j'enlève le cran de sureté de mon Browning. » (Cette phrase a également été prononcée en public par Baldur von Schirach, chef des Jeunesses hitlériennes).
L'identité sociale des individus laisse place au sentiment d'appartenance à une masse informe, sans valeur aux yeux du pouvoir, ni même à ses propres yeux. La dévotion au chef et à la nation devient la seule raison d'être d'une existence qui déborde au-delà de la forme individuelle pour un résultat allant du fanatisme psychotique à la neurasthénie. La domination totale est réalisée : les « ennemis objectifs » font leur autocritique pendant leurs procès et admettent la sentence. Les agents du NKVD russe arrêtés avaient ainsi un raisonnement du type « si le Parti m'a arrêté et désire de moi une confession, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire ». Arendt remarque en outre qu'aucun agent arrêté n'a jamais tenté de dévoiler un quelconque secret d'État, et est toujours resté fidèle au pouvoir en place, même lorsque sa mort était assurée.
Les sociétés totalitaires se distinguent par la promesse d'un « paradis », la fin de l'histoire ou la pureté de la race par exemple, et fédèrent la masse contre un ennemi objectif. Celui-ci est autant extérieur qu'intérieur et sera susceptible de changer, suivant l'interprétation des lois de l'Histoire (lutte des classes) ou de la Nature (lutte des races) à l'instant « t ». Les sociétés totalitaires créent un mouvement perpétuel et paranoïaque de surveillance, de délation et de retournement. Les polices et les unités spéciales se multiplient et se concurrencent dans la plus grande confusion.
Contrairement aux dictatures traditionnelles (militaires ou autres), le totalitarisme n'utilise pas la terreur dans le but d'écraser l'opposition. La terreur totalitaire ne commence réellement que lorsque toute opposition est écrasée. Même si le groupe considéré comme un ennemi a été anéanti (par exemple les trotskistes en URSS), le pouvoir en désignera continuellement un autre. Hitler et les nazis avaient ainsi prévu l'extermination des peuples ukrainiens, polonais et russes une fois les Juifs éliminés.
Des purges régulières ordonnées par le chef de l'État, seul point fixe, donnent le tempo d'une société qui élimine par millions sa propre population, se nourrissant en quelque sorte de sa propre chair. Ce programme est appliqué jusqu'à l'absurde, les trains de déportés vers les camps de concentration et d'extermination de l'Allemagne nazie restèrent toujours prioritaires sur les trains de ravitaillement du front alors même que l'armée allemande perdait la guerre. Les régimes totalitaires se distinguent des régimes autoritaires et dictatoriaux par leur usage permanent de la terreur, contre l'ensemble de la population (y compris les « innocents » aux yeux même de l'idéologie en vigueur) et non contre les opposants réels. L'usage permanent de la terreur a pour corollaire celui de la propagande, omniprésente dans un État totalitaire.
Par ailleurs, le totalitarisme n'obéit à aucun principe d'utilité : les structures administratives sont démultipliées sans se superposer, les divisions du territoire sont multiples et ne se recoupent pas. La bureaucratie est consubstantielle du totalitarisme. Tout cela a pour but de supprimer toute hiérarchie entre le chef et les masses, et garantir la domination totale, sans aucun obstacle la relativisant. Le chef commande directement et sans médiation tout fonctionnaire du régime, en tout point du territoire. Le totalitarisme est à différencier de l'absolutisme (le chef tient sa légitimité des masses et non d'un concept extérieur comme Dieu) et de l'autoritarisme (aucune hiérarchie intermédiaire ne vient théoriquement « relativiser » l'autorité du chef totalitaire).
Dans son introduction d’une nouvelle édition de The Origins of Totalitarianism, en 1966, Hannah Arendt s’est opposée à l’usage idéologique du terme de totalitarisme concernant tous les régimes communistes à parti unique. Elle considérait que son interprétation ne s’appliquait pas plus aux successeurs de Staline qu’à son prédécesseur.
Michelle-Irène Brudny considère que la pensée de Hannah Arendt comporte des exagérations, dans sa prétention de tout englober : « le philosophe, parfois intrépide ou, plus sûrement, devenu téméraire par sa volonté obsessive de comprendre, se sent tenu, au risque du paradoxe, de produire une interprétation "générale". » L’ouvrage d'Arendt a néanmoins convaincu la majorité de l’opinion et reçu de nombreux éloges.
Définition selon Claude Lefort
Claude Lefort fait partie des théoriciens du politique qui postulent la pertinence d’une notion de totalitarisme dont relèvent le stalinisme comme le fascisme, et considèrent le totalitarisme comme différent en son essence des grandes catégories utilisées par le monde occidental depuis la Grèce antique, comme les notions de dictature ou de tyrannie. Cependant, contrairement aux auteurs comme Hannah Arendt qui limitent la notion à l’Allemagne nazie et à l’Union soviétique entre 1936 et 1953, Lefort l’applique aux régimes d’Europe de l’Est dans la deuxième moitié du XXe siècle, c’est-à-dire à une époque où la terreur, un élément central du totalitarisme chez d’autres auteurs, avait perdu sa dimension paroxystique. C’est à l’étude de ces régimes, et à la lecture notamment de L'Archipel du Goulag (1973) d’Alexandre Soljenitsyne, qu’il a développé son analyse du totalitarisme. Sans la théoriser en un ouvrage unifié, il a publié en 1981 sous le titre L'Invention démocratique : les limites de la domination totalitaire un recueil d’articles parus entre 1957 et 1980.
D'autres contributions à la réflexion philosophique sur le totalitarisme
Joseph Goebbels, ses enfants et des dignitaires faisant le salut nazi à la fête de noël 1937.
De nombreux philosophes, cherchant à trouver une explication aux tragédies du XXe siècle, ont traité de la question du totalitarisme. Le courant philosophique recherchant « l’essence » du totalitarisme a mis l’accent sur son contenu idéologique et ses méthodes.
Le fascisme, le nazisme et le stalinisme ont été interprétés en tant que « religions séculières ». Le philosophe allemand Eric Voegelin a construit une analyse du XXe siècle sur la base de cette notion18. Les idéologies totalitaires remplaçaient la religion, car elles demandaient à leurs adeptes de croire à la promesse d’un salut sur terre.
Pour Marcel Gauchet, certains totalitarismes comme le stalinisme, le fascisme et le nazisme sont des « religions séculaires », des expériences de croyance qui entrainaient le fanatisme. Au delà de leur antagonisme premier, ce qui unit ces totalitarismes et font leur séduction est la restauration sous des formes modernes de sociétés passées qui étaient organisée par la religion: recours au culte de la personnalité, sacralisation du lien entre le peuple et l'État via le parti unique comme auparavant le clergé, obsession propagandiste et de l'unité de la foi.
Soutenue par plusieurs auteurs, l'assimilation plus ou moins poussée de l'idéologie totalitaire à la religion a été critiquée par Hannah Arendt pour qui le fait que l'idéologie accomplit une fonction similaire à celle de la religion ne justifie pas de confondre les deux notions.
Waldemar Gurian, historien et essayiste d’origine russe émigré aux États-Unis en 1937, a introduit la notion d’« idéocratie ». Selon Gurian, les totalitarismes bolchevique et nazi, en tant que régimes engendrés et structurés par une idée, étaient « idéocratiques ». L’idéocratie désignait toute forme d’organisation politique où il y avait fusion entre le pouvoir et une idéologie donnée. Le terme s’appliquait fréquemment aux régimes où un parti unique avait la mainmise sur l’appareil étatique.
L’historien israélien Jacob L. Talmon a également perçu le totalitarisme comme le produit d’une idée. D’après lui, le totalitarisme avait sa matrice dans la philosophie des Lumières. L’intelligentsia russe a été influencée par le messianisme politique du XVIIIe siècle, c’est-à-dire par l’annonce d’un avenir radieux et par l’affirmation qu’il existe en politique une vérité, une seule. Jacob Talmon considérait Jean-Jacques Rousseau (auteur de la théorie de la volonté générale), Maximilien de Robespierre (le premier praticien de la Terreur) et Gracchus Babeuf (le premier conspirateur communiste) comme des précurseurs du totalitarisme.
Alain Besançon a repris l'analyse du totalitarisme comme idéocratie : « L'idéologie n'est pas un moyen du totalitarisme mais au contraire le totalitarisme est la conséquence politique, l'incarnation dans la vie sociale de l'idéologie». Comme Jacob Talmon, Alain Besançon voit dans la Révolution française la matrice du totalitarisme et porte un regard très critique sur l'héritage rationaliste des Lumières.
Le modèle totalitaire
Dans les années 1950, le concept de totalitarisme a été perfectionné en un « modèle » par des politologues soucieux d’aboutir à une catégorisation des régimes politiques. Le modèle du totalitarisme a été formé par opposition à d’autres modèles, comme les modèles des régimes « démocratiques-constitutionnels » et « autoritaires-conservateurs ».
Sous le titre de Permanent Revolution, Sigmund Neumann a publié une étude sur le totalitarisme en 1940. Il insistait sur le fait que l'État totalitaire menait une « révolution permanente », tandis que les autoritarismes traditionnels avaient généralement été conservateurs. Selon Neumann, le caractère principal des régimes totalitaires était d'institutionnaliser la révolution, ce qui leur permettait d'assurer leur propre perpétuation.
Mais lorsque les historiens s'emparent du concept, c'est beaucoup plus selon la définition fixée, à l'origine, par le politologue Carl Friedrich, qui a permis au concept de totalitarisme d'acquérir sa pleine légitimité dans le domaine des sciences sociales. L'ouvrage écrit par Friedrich et son jeune collaborateur de l'université Harvard Zbigniew Brzezinski est, selon Enzo Traverso, « le livre qui a le plus polarisé le débat pendant les années cinquante et soixante ». Leur analyse du totalitarisme a représenté pendant longtemps le traitement théorique qui a fait le plus autorité. Les deux auteurs présentaient un « syndrome » du totalitarisme comportant cinq caractéristiques fondamentales : (1) un parti unique contrôlant l'appareil d'État et dirigé par un chef charismatique ; (2) une idéologie d'État promettant l'accomplissement de l'humanité ; (3) un appareil policier recourant à la terreur ; (4) une direction centrale de l'économie et ; (5) un monopole des moyens de communication de masse. Dans cette vision, les dictatures totalitaires, en tant que forme nouvelle et extrêmement moderne d'autoritarisme, étaient la forme achevée du despotisme. De plus, les sociétés totalitaires étaient présentées comme fondamentalement semblables entre elles. On peut y ajouter comme autres aspects pratiques, la prise en main totale de l'éducation pour la baser sur l'idéologie et la mise en place d'un réseau omniprésent de surveillance de l'individu. Une prépondérance était accordée au facteur technique : c’est la technologie moderne qui rendait le pouvoir politique capable d’avoir une emprise totale sur les populations. L’État totalitaire consistait en une énorme bureaucratie, laquelle faisait preuve d’une efficacité sans failles. Une des caractéristiques du totalitarisme était qu’il enrégimentait physiquement et mentalement la population. L’idéologie constituait un instrument de gouvernement sans pareil, par l'endoctrinement des populations. La propagande avait l’effet d’un lavage de cerveau, permettant d’obtenir l’assentiment du peuple. Selon Claude Polin, les idéologies totalitaires permettaient « de mettre les esprits même en esclavage, et de tarir toute révolte à sa source vive, en ôtant jusqu’à son intention même ».
Les politologues de cette période tiraient des conclusions très pessimistes à propos du futur. Selon eux, il était improbable que la dictature totalitaire, compte tenu de sa dynamique interne, s’effondre d’elle-même ou soit renversée par une révolution. Il y avait aussi d’énormes obstacles à la libéralisation du régime, étant donné la loi arbitraire et l’absence d’initiative démocratique. Les structures du totalitarisme le rendaient incapable d’évoluer, mais pas incapable de se reproduire. Cet État tout-puissant tâchait même d’étendre son emprise sur l’ensemble du monde. Les projets totalitaires de révolution mondiale semblaient seulement pouvoir être contrecarrés par une intervention militaire extérieure, comme cela s’était passé face au nazisme.
Dans son premier livre traitant du totalitarisme soviétique, Brzezinski mettait l’accent sur la mobilisation totale des ressources par l’État, sur l’anéantissement de toute opposition et sur la terreur générale. La purge, perçue comme le noyau du totalitarisme, « satisfait les besoins du système en dynamisme et en énergie continuelle ». Dans cet ouvrage, Brzezinski prévoyait la constante aggravation du totalitarisme. Les mouvements totalitaires étaient particulièrement redoutables car « leur dessein est d’institutionnaliser une révolution qui progresse en étendue, et souvent en intensité, à mesure que le régime se stabilise au pouvoir. L’objectif de cette révolution est de pulvériser toutes les unités sociales existantes afin de remplacer l’ancien pluralisme par une unanimité homogène».
La destruction de la société ancienne, par l’application croissante de mesures de coercition, était menée afin de reconstruire cette société et l’homme lui-même en fonction de certaines conceptions « idéales » définies par l’idéologie. « La terreur devient donc une conséquence inévitable, ainsi qu’un instrument, du programme révolutionnaire. » Dans son analyse du totalitarisme soviétique, Brzezinski accordait un grand poids à l’idéologie révolutionnaire qui, une fois prise en main par un parti unique bureaucratisé, engendrait un impact social total.
Le politologue reconnaît que « le système politique de Khrouchtchev n’est pas le même que celui de Staline, bien que les deux puissent être généralement décrits comme totalitaires. » Sous Khrouchtchev, la terreur a laissé place à une politique d’endoctrinement qui est devenue la principale caractéristique du système. Mais quand le dynamisme et le zèle révolutionnaires décroissent, « le système est renforcé par des réseaux de contrôle complexe qui imprègnent toute la société et mobilisent ses énergies à travers une pénétration très fine. »
Betty Brand Burch a résumé ainsi la définition classique du totalitarisme : « le totalitarisme est une forme extrême de dictature qui est caractérisée par le pouvoir illimité et démesuré des dirigeants, la suppression de toutes formes d’opposition autonome, et l’atomisation de la société d’une façon telle que quasiment chaque phase de la vie devient publique et donc sujette au contrôle de l’État. »
D'après la définition de Raymond Aron, le totalitarisme qualifie les systèmes politiques dans lesquels s'accomplit « l'absorption de la société civile dans l'État » et « la transfiguration de l'idéologie de l'État en dogme imposé aux intellectuels et aux universités ». L'État, relayé par le parti unique, exercerait en ce sens un contrôle total sur la société, la culture, les sciences, la morale jusqu'aux individus mêmes auxquels il n'est reconnu aucune liberté propre d'expression ou de conscience.
Un enjeu de débat :Un concept très politisé
L'emploi du concept de totalitarisme a été refoulé durant la période de la Seconde Guerre mondiale, du fait de l'alliance des démocraties occidentales avec l'Union soviétique dans la lutte contre l'Allemagne nazie. Le concept a connu son âge d'or à partir de la proclamation de la doctrine Truman, en 1947. L'analogie entre l'Allemagne de Hitler et la Russie de Staline laissait à penser que la Guerre froide était simplement une répétition des années 1930, car la Russie soviétique pouvait se comporter de la même manière que l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres. Selon Les Adler et Thomas Paterson, le « cauchemar d'un "fascisme rouge" a terrorisé une génération d'Américains ». La notion de totalitarisme, qui a fait l'objet d'un nombre considérable de travaux et dont l'usage était très répandu, se formulait alors dans une connotation strictement négative.
Staline, Franklin Delano Roosevelt et Winston Churchill à la Conférence de Téhéran en 1943.
L'économiste Friedrich Hayek, dans La Route de la servitude, percevait le totalitarisme comme une conséquence inéluctable de l’application des mesures socialistes à l’économie. Il montrait que la socialisation de l’économie ne pouvait que déboucher sur la suppression totale des libertés, y compris des libertés politiques, donc que le socialisme était structurellement incompatible avec la démocratie. Friedrich Hayek pensait que des liens systémiques unissaient l’économie, le droit et les institutions politiques. S’opposer au libre fonctionnement des mécanismes du marché, dans lequel il voyait la source ultime de toute civilisation, reviendrait à installer un régime tyrannique. L’idée selon laquelle la planification économique serait le principe du totalitarisme a connu un important succès aux États-Unis. Dans The Fatal Conceit, Friedrich Hayek a repris une dernière fois sa critique du socialisme, qu’il considérait comme une erreur fatale et le produit de la vanité intellectuelle.
Pour Bertrand de Jouvenel, c'est la démocratie qui est totalitaire : il a ainsi intitulé l'un des chapitres de son ouvrage principal Du pouvoir « La démocratie totalitaire » Il considère que la démocratie en laissant l'espoir à chacun d'accéder au pouvoir incite à la prise du pouvoir et non à la réduction de l'« arbitraire étatique », phénomène entraînant un renforcement toujours plus grand des États.
Dans les années 1970, la notion de totalitarisme a été adoptée par des intellectuels d’Europe de l’Est émigrés en Occident, tels Leszek Kolakowski, Michel Heller ou Alexandre Zinoviev. Bien des dissidents de l’Est reproduisaient au travers de leurs travaux les descriptions les plus classiques du totalitarisme. Ils ont insisté de manière unanime sur le succès des politiques totalitaires. D’après Kolakowski, le système stalinien était un « système politique où tous les rapports sociaux ont été étatisés et où l’État omnipotent se retrouve seul face à des individus réduits à l’état d’atomes ». Le stalinisme était « un marxisme-léninisme en action », c’est-à-dire le résultat inévitable de la mise en pratique de la vision du monde marxisme-léninisme.
Les critiques précoces adressées à la théorie du totalitarisme
Les recherches sur la notion de totalitarisme se sont effectuées dans le contexte politique de la Guerre froide, où le modèle libéral s'opposait au modèle communiste. Après avoir été instrumentalisé par le maccarthisme aux États-Unis dans les années 1950, le concept de totalitarisme a commencé à être désavoué au cours des années 1960 par la recherche empirique des sciences sociales, dans le cadre d'un mouvement général de remise en question du libéralisme, favorisée par la détente. De nouvelles interprétations sont alors apparues : d'une part l’hostilité générale envers l’URSS faiblissait, d’autre part, les nouvelles relations entre les États-Unis et l’URSS ont entraîné des échanges intellectuels entre les deux pays (les chercheurs occidentaux étaient autorisés, bien plus que dans le courant des années 1950, à travailler dans les archives et les bibliothèques soviétiques). Il apparaissait évident que, dans les faits, l’État soviétique n’était pas parvenu à « atomiser » la société ou à éliminer la vie privée : les théoriciens du totalitarisme avaient surestimé les capacités du pouvoir soviétique à contrôler la société, et sous-estimé les capacités de résistance des individus.
Richard Nixon et Nikita Khrouchtchev.
Le concept de totalitarisme excluait la possibilité de tout changement important du système, autrement que par une défaite militaire.[réf. nécessaire] Or, après la mort de Staline, à partir de Khrouchtchev, l'Union soviétique avait commencé à changer, ce qui infirmait l’immobilisme prêté au système par le « modèle totalitaire ». La terreur s’était apaisée (pourtant considérée comme une caractéristique fondamentale du totalitarisme), le pouvoir personnel de Staline avait laissé place à une direction collective, des groupes de la nomenklatura bénéficiaient d’un rôle accru, la « purge permanente » avait laissé place au souci de sécurité de l’oligarchie. L’idéologie servait à la justification du pouvoir en place plutôt que de moteur dynamique de transformation de la société. Enfin, la consommation et l’économie parallèle progressaient et le pays s’ouvrait économiquement vers l’extérieur. Les théoriciens du totalitarisme comme Hannah Arendt et Zbigniew Brzezinski avaient mis au premier plan de leur analyse les formes extrêmes des dictatures dites totalitaires, qui se sont révélées, en URSS comme plus tard en Chine populaire, liées dans une très large mesure à la personne du tyran. La théorie du totalitarisme n’avait pas envisagé la possibilité que ces régimes s’engagent dans un processus d’apaisement de la dictature.
La pertinence du concept de totalitarisme et son utilité pour l’analyse historique et comparative ont alors été remises en question par une nouvelle génération de politologues américains. Ce concept, perçu comme une survivance de la Guerre froide, était accusé de sous-estimer la complexité des régimes auxquels il s’appliquait. Alexander J. Groth émettait des doutes sur la capacité du concept de totalitarisme à comprendre correctement l’Italie fasciste, l’Allemagne nazie et l’Union soviétique. Ce concept se concentrait sur les traits que ces régimes avaient en commun, alors que leurs différences méritaient une plus grande attention. Les Adler et Thomas Paterson partageaient cette opinion : « les différences réelles entre les systèmes fasciste et communiste ont été obscurcies ». Pourtant, poursuivaient-ils, les origines, les idéologies, les buts et les pratiques de ces systèmes étaient largement différents. La recherche historique a peu à peu mis en cause la légitimité du parallèle entre national-socialisme et communisme, en soulignant notamment la spécificité du génocide nazi, et plus généralement la singularité de régimes qui n’ont pas les mêmes origines.
Selon Robert C. Tucker, la comparaison entre l’Allemagne nazie et la Russie communiste était trop étroite. De plus, de nombreux auteurs convaincus que le régime soviétique découle de déviations historiques qui trahissent l'idéologie communiste, reprochent au « modèle totalitaire » d’établir une filiation entre le communisme, le bolchevisme et le stalinisme. Cette filiation considère le monde communiste comme un tout, et n’est que peu sensible aux différences existant entre les pays communistes. Dans un article, Herbert J. Spiro regrettait le fait que le terme de totalitarisme ait été un slogan anticommuniste durant la Guerre froide : l’usage propagandiste du terme « a eu tendance à obscurcir l’utilité qu’il pouvait avoir pour l’analyse systématique et la comparaison des entités politiques ». Benjamin Barber, pourtant ancien défenseur de la théorie du totalitarisme, appelait au dépassement d’un concept condamné « sinon par l’oubli, du moins par une désuétude croissante». John Alexander Armstrong, intellectuel conservateur, a lui aussi critiqué explicitement le concept de totalitarisme à la fin des années 1960, arguant qu’il n’était pas capable de rendre compte de l’évolution de plusieurs régimes communistes.
L’expérience de démocratisation menée en Tchécoslovaquie lors du « printemps de Prague » de 1968 a rouvert le débat sur le changement dans les pays communistes et sur les différences entre ceux-ci. Le paradigme du totalitarisme est ainsi entré en conflit avec les nouveaux domaines de recherche qui intéressaient les spécialistes en sciences sociales et les historiens qui s’ouvraient aux méthodes des sciences sociales. Le « modèle totalitaire », par exemple, n’encourageait pas les études portant sur les rapports et les différences entre le centre et la périphérie. Georges Mink par exemple, dans Vie et Mort du bloc soviétique, préfère parler de soviétisation/désoviétisation lorsqu'il s'agit d'aborder les pays du bloc de l'Est (URSS et pays satellites).
Néanmoins, l’idée de totalitarisme n’était pas complètement écartée : elle désignait une phase caractéristique des débuts de la domination communiste qui exigeait la mobilisation de la société, le plus souvent pour cause d’industrialisation. Suite à cette phase d’industrialisation, l’élite révolutionnaire s’est bureaucratisée et la société communiste est devenue bien plus complexe et différenciée. C'est pourquoi, en comparaison avec l'Allemagne nazie de Hitler, certains chercheurs limitent la période totalitaire au régime de Staline, particulièrement dans ses dernières années (1950-1953), où la paranoïa de Staline atteignit son paroxysme. À partir de 1970, le constat que les régimes communistes n’étaient pas statiques, mais qu’ils traversaient au contraire différentes phases, faisait quasi-unanimité parmi les universitaires. Ils étaient nombreux à estimer que de nouveaux modèles théoriques étaient nécessaires pour étudier les États et les sociétés communistes dans la période post-stalinienne.
Dans la soviétologie, le débat autour de la notion de totalitarisme a opposé deux écoles historiographiques. L'« école du totalitarisme », après avoir été dominante aux États-Unis dans les années 1950-1960, a été contestée par une école « révisionniste », qui a remis en question les fondements de la soviétologie par le biais de l'histoire sociale.
Les critiques contemporaines
Dans les sciences humaines, le terme a donné lieu à un débat qui n'est toujours pas clos. Le terme a donné lieu à de nombreuses définitions, différentes et parfois antagonistes selon les convictions des auteurs. Certains auteurs qualifient de totalitaires des régimes comme l'Allemagne sous Adolf Hitler, l'URSS sous Staline, le Turkménistan sous Saparmyrat Nyýazow, la Corée du Nord sous Kim Il-sung puis Kim Jong-il, le Cambodge sous Pol Pot (Khmers rouges), L'Iran sous Khomeini, Cuba sous Fidel Castro, la Chine à l'époque de Mao Zedong51 ou l'Afghanistan sous les Talibans. L'Empire du Japon de 1932 à 1945 ainsi que la Première République française du temps de la Terreur présentent de nombreux caractères totalitaires.
Les politologues des débuts de la Guerre froide ont beaucoup cité Hannah Arendt pour sa comparaison entre Allemagne nazie et Russie soviétique, mais contrairement à elle, ils n’ont pas creusé le problème du point de vue social et historique. Carl Friedrich et son école se sont bornés à l’analyse des régimes totalitaires une fois constitués, quitte à négliger la question de leurs origines. Comme le dit Enzo Traverso, « l’affinité essentielle entre l’Allemagne nazie et l’URSS était postulée sur la base d’une simple comparaison phénoménologique, statique, descriptive, jamais étudiée à partir de la genèse et de la dynamique de ces régimes. » Friedrich semble s’excuser : « pourquoi les sociétés totalitaires sont ce qu’elles sont, nous ne le savons pas». D’après l'historien Enzo Traverso, la principale conséquence de l’application des concepts d’idéocratie et de religion séculière a été « de déshistoriser le fait totalitaire, qui ne sera pas étudié comme résultat d’un processus social et politique mais réduit à l’incarnation d’une idée. »
Dans un article au titre éloquent, Ian Kershaw marque ses fortes réticences à l'égard de la théorie du totalitarisme. Concernant le Troisième Reich, l'historien anglais conteste l'atomisation de la société civile, premier des traits du totalitarisme selon Hannah Arendt. Son étude sur la Bavière lui permet d'affirmer qu'une opinion populaire demeure, indépendamment de l'idéologie nazie. La société a su s'appuyer sur ses traditions pour exprimer ses doléances ou pour opposer une résistance ponctuelle, elle ne s'est donc pas réduite à « l'homme unique » dont Arendt parlait. Selon Kershaw, le concept de totalitarisme « aide, contre la propre volonté de la plupart de ses utilisateurs, à marquer les différences radicales qui existent » entre les deux régimes stalinien et nazi. Il conclut en considérant que « le concept de totalitarisme a un pouvoir essentiellement descriptif, très faiblement explicatif - ce en quoi il n'est peut-être d'ailleurs pas un concept».
Dans leur ouvrage commun, paru en 2003, Alain Blum et Martine Mespoulet regrettent que l'« approche totalitaire postulant la nature essentiellement politique de l'histoire soviétique, la société n'a guère de place dans cette analyse ». Concernant l'Union soviétique, « le débat autour du totalitarisme a souvent occulté la complexité de l'organisation du commandement, et plus généralement des formes du gouvernement stalinien ». De manière plus directe, Roland Lew, historien spécialiste de la Chine maoïste, parle d'un paradigme « profondément obsolète », basé sur « une conception largement a-historique », qui « n'a continué à vivre et même à prospérer que grâce à l'affrontement idéologique». Le 25 janvier 2006, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adoptait une Résolution sur la nécessité d’une condamnation internationale des crimes des régimes communistes totalitaires.
Le Parlement européen a exprimé à plusieurs reprises son opposition aux régimes totalitaires. Le 23 septembre 2008, il publiait une déclaration sur la proclamation du 23 août comme journée européenne de commémoration des victimes du stalinisme et du nazisme . Le 2 avril 2009, il adoptait à la majorité absolue une résolution condamnant les régimes totalitaires, en particulier communistes et nazi.
Un concept indispensable malgré tout ?
Malgré les critiques, l’analyse au travers du prisme du totalitarisme n’a pas été abandonnée. De nombreux auteurs en ont défendu la valeur heuristique. Le Polonais Leszek Kolakowski reconnaissait qu’« un modèle parfait d’une société totalitaire est introuvable». Mais d’après le philosophe polonais, cela ne constituait pas un obstacle sérieux à l’utilisation du concept, étant donné que les concepts employés pour décrire les phénomènes sociaux de grande échelle n’avaient jamais d’équivalents empiriques parfaits. Il pouvait y avoir des changements significatifs en URSS, mais sans transformation fondamentale du communisme, le contrôle total ayant toujours été l’objectif d’un parti qui se voulait omnipotent.
L'Américain Martin Malia s’est lui aussi inspiré de la pensée weberienne : le totalitarisme est un idéal-type, « toujours imparfaitement réalisé dans le domaine empirique ». Un idéal-type est une abstraction qui ne se retrouvera jamais telle quelle dans la réalité, mais qui permet néanmoins l’intelligibilité du phénomène sur le plan conceptuel, sa compréhension. Selon l'historien américain, le mot « totalitaire » ne veut pas dire que « des régimes de ce genre exerçaient de fait un total contrôle de la population (puisque c'est impossible), mais qu'un tel contrôle était leur aspiration fondamentale ». Les régimes tentent d'être totalitaires, mais la résistance des faits, de la réalité sociale ou économique, et la résistance active ou passive des populations, les en empêchent, et parviennent à préserver des espaces non-contrôlés.
La théorie du totalitarisme a connu un nouvel essor dans les années 1990. L'effondrement de l'URSS, en 1991, a partiellement donné raison à ses partisans. Les historiens de l'école révisionniste soutenaient majoritairement que le régime soviétique était un État moderne, puisqu'il était réformable. Or, les tentatives de restructuration menées par Mikhaïl Gorbatchev ont conduit à la ruine complète du système. Martin Malia annonça dès 1990 l'échec de la perestroïka dans un article publié anonymement qui connut un certain retentissement. Il y expliquait notamment que Gorbatchev échouerait parce qu'il restait trop « communiste » et que le système soviétique n'était pas réformable. Il présentait le régime « totalitaire » soviétique comme reposant sur quatre piliers intangibles : (1) « le rôle dirigeant du parti […] ; (2) la planification économique autoritaire ; (3) la police politique et (4) l'idéologie obligatoire ». Selon Malia, toucher à l'un de ces piliers, tous indispensables au maintien du système, revenait à provoquer son « écroulement total ». Pour de nombreux historiens, le totalitarisme reste un concept-clé dans l'étude et la compréhension du XXe siècle. Pour Enzo Traverso, il est « un garde-fou de la pensée » : il « condense une image du XXe siècle dont l'oubli empêcherait de fonder une attitude responsable, tant sur le plan éthique que sur le plan politique, dans le présent ». En conclusion, l'historien italien juge le concept à la fois incontournable et insuffisant : « incontournable pour la théorie politique, soucieuse de dresser une typologie des formes de pouvoir, et pour la philosophie politique, confrontée à la nouveauté radicale des régimes visant l'anéantissement du politique ; insuffisant pour l'historiographie, confrontée à la concrétude des événements. »
Extension du concept au XXIe siècle
Le mot « totalitarisme », entré dans le langage courant, est bien souvent utilisé sans les précautions méthodologiques nécessaires. Ayant une connotation forte, faisant penser aux régimes hitlérien et stalinien, il jette le discrédit facilement et marque les esprits. Il peut donc servir d'arme de propagande contre l'ennemi. L'usage du concept requiert une analyse approfondie de la société ou de la structure du groupe étudié, il faut en faire ressortir les catégories essentielles et les processus de dé-différenciation propres au totalitarisme. Ainsi, la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle ont vu fleurir de nouveaux